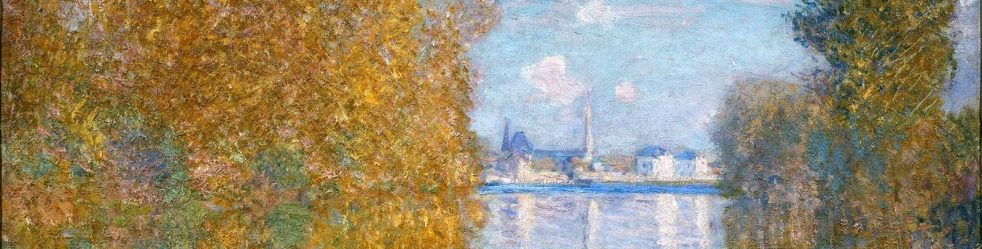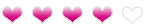Yvane Jacob est historienne de la mode et auteure, diplômée d’un master en communication de Sciences Po Bordeaux (2006-2010) et de l’Institut français de la mode (2011-2012). Elle est responsable de collection chez & Other Stories depuis 2015.
Le vêtement a-t-il libéré la femme ? Ou la femme s’est-elle libérée de ses vêtements ? S’agit-il bien d’une lutte ? En quoi le vestiaire féminin a-t-il entravé l’émancipation féminine ?
Avec Parées, Yvane Jacob revient sur l’histoire du vêtement féminin, avec humour et dérision, elle a interrogé les plus grands chercheurs en histoire pour comprendre, à l’aune du tissu qui les couvre ou les dévoile, le long cheminement de l’émancipation des femmes.
Découpé en cinq parties, l’autrice part de la pudeur médiévale et la naissance de la différenciation sexuelle à la contrainte absolue de La Renaissance, pour arriver aux premières revendications féministes du XIXe siècle jusqu’à la libération du XXe siècle.
Ornement ou outil de contrôle du corps féminin, le vêtement devient peu à peu une façon de s’affirmer et de gagner en puissance.
Vous le savez, la condition féminine est un sujet que j’aime retrouver dans mes lectures, cet ouvrage ne pouvait donc que m’intéresser, et trêve de suspens, ce fut le cas !
Ce livre est absolument passionnant, il est très érudit, très riche et instructif. Le style d’Yvane Jacob est fluide, teinté de beaucoup d’humour et l’ouvrage ne vire jamais à la leçon d’Histoire.
Yvane Jacob retrace donc l’histoire du vêtement féminin, avec quelques précisions sur la vêture masculine tout de même. On voit ainsi l’importance du vestiaire sur l’émancipation féminine car l’autrice fait met en parallèle entre l’évolution des vêtements et celle de la condition féminine.
Entravée par ses vêtements, la femme l’est aussi dans la société de son époque. Eternelle mineure, passant de l’obéissance à son père à celle de son mari, la femme n’est pas libre de choisir ses vêtements et ceux-ci l’empêche de mener une existence plus libre.
L’émancipation des femmes par le vêtement, qui n’est pas aussi linéaire qu’on peut le penser, est donc tout autant une question de mode que de science politique.
Petits bémols toutefois : aucune image ou illustration ne vient étayer les propos d’Yvane Jacob, ce que je trouve un peu dommage car cela nous oblige à chercher sur le net et donc à nous sortir régulièrement de la lecture. Et c’est un livre de journaliste, Yvane Jacob compulse les travaux menés par les chercheurs et nous les synthétise, il n’évite donc certainement pas certains écueils.
Malgré tout, je ne peux que vous recommander cet ouvrage que j’ai trouvé très bien fait et réellement passionnant !