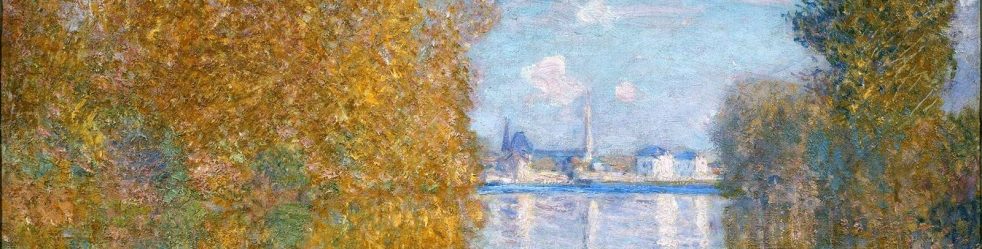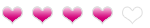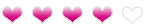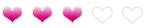Né en 1975, Romain Puertolas grandit dans le Sud de la France. À 25 ans, il part s’installer à Barcelone puis Brighton (Angleterre) avant de retourner en Espagne à Madrid où il travaille dans l’aviation et plus tard comme professeur. À 35 ans, il obtient le concours de lieutenant de police et s’installe alors à Paris. À la sortie du Fakir, et grâce à son succès, il se met en disponibilité de la police (il est désormais capitaine) et se consacre depuis 2014 à ses romans et à leur adaptation au cinéma. Il a publié chez Albin Michel La Police des fleurs, des arbres et des forêts et Sous le parapluie d’Adélaïde en 2019 et 2020.
La photo a fait le tour du monde. Xavier Dupont de Ligonnès retirant trente euros à un distributeur automatique du sud de la France quelques jours après avoir « supposément » assassiné de sang-froid sa femme, leurs quatre enfants et leurs deux chiens.
Pour Romain Puértolas, ce fut un choc, une espèce de mission dont il se sent aussitôt investi. Cette histoire l’obsède depuis 2011. Treize ans ont passé sans qu’il cesse une seule seconde de penser à lui. Il est capitaine de police et écrivain, la combinaison parfaite pour se lancer dans l’enquête de sa vie.
Ligonnès hante ses jours et surtout ses nuits. Il n’y a qu’une seule manière pour mettre fin à cette torture, retrouver Xavier Dupont de Ligonnès…
Comment j’ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès est un roman-enquête, dans lequel Romain Puértolas, ancien capitaine de police et auteur à succès de L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, lie avec brio une rigoureuse investigation policière à une fiction aussi étonnante que jubilatoire.
Je ne suis pas une grande adepte des faits divers, mais comme tout le monde je crois, je me rappelle très bien L’affaire Dupont de Ligonnès qui m’a horrifiée. Un quintuple meurtre non élucidé survenu à Nantes, à une heure de chez moi. Cinq membres de la famille Dupont de Ligonnès : la mère, Agnès, et ses quatre enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît, sont assassinés entre le 3 et le 6 avril 2011. Leurs corps sont retrouvés le 21 avril 2011 sous la terrasse de leur maison nantaise.
Le père de famille et principal suspect des assassinats, Xavier Dupont de Ligonnès, est vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Depuis, il fait régulièrement l’objet d’articles centrés dans la presse nationale où il est considéré comme «l’homme le plus recherché de France».
Depuis, on ne compte plus les livres et les émissions sur cette affaire et on a tout imaginé : s’est-il suicidé ? A-t-il trouvé refuge dans un monastère ? Est-il parti à l’étranger ? Les policiers continuent à étudier toutes les pistes et à enquêter à chaque fois que quelqu’un dans le monde signale l’avoir vu.
Mais pour Romain Puértolas l’enquête n’a pas été suffisamment poussée pour retrouver l’homme le plus recherché de France, car cela ne fait aucun doute, pour l’auteur comme pour moi, l’auteur de ce quintuple meurtre est bel et bien vivant.
Alors l’ancien policier qu’il est, reprend l’enquête de A à Z et imagine des scénarios tous finalement crédibles. Il se met aussi en scène, en inventant des scènes où son voisin est Dupont de Ligonnès et qu’il finit par l’assassiner, nous retraçant aussi son procès pour meurtre avec un dénouement pas piqué des hannetons.
Mêlant sa vie réelle et la fiction, il nous propose un récit cocasse et plein d’humour mais aussi une enquête très sérieuse, qu’il m’a été impossible à lâcher ! Dès les premières lignes, l’auteur m’a happé et j’ai lu ce récit quasiment d’une traite.
Si vous n’avez pas peur du loufoque et que vous vous intéressez à l’enquête, je vous le conseille chaudement. Pour ma part, j’ai appris beaucoup de choses sur cette affaire et malgré la gravité des faits, je me suis aussi amusée car ce récit traite surtout de la cavale de XDDL et pas sur les meurtres.