Pour éviter le scandale et protéger les intérêts de leur fille, Bernard Desqueyroux, que sa femme Thérèse a tenté d’empoisonner, dépose de telle sorte qu’elle bénéficie d’un non-lieu. Enfermée dans sa chambre, Thérèse tombe dans une prostration si complète que son mari, effrayé, ne sait plus quelle décision prendre. Doit-il lui rendre sa liberté ? 

Par une porte dérobée, une femme sort du Palais de justice de Bordeaux. Thérèse Desqueyroux vient de bénéficier d’un non-lieu pour tentative de meurtre : elle ne sera donc pas poursuivie par la justice, l’honneur est sauf pour les Desqueyroux et pour son père, député-maire de la commune dont elle est originaire.
Et pourtant tous la savent coupable : son père qui est venu la chercher, son avocat qui l’accompagne, son mari qui l’attend en leur propriété d’Argelouse. Sur le chemin qui la ramène à Argelouse, son village, Thérèse s’interroge et revient sur les événements qui l’ont poussée à empoisonner son mari…
Thérèse Desqueyroux fait partie de ces classiques qui croupissent depuis de nombreuses années dans ma PAL, je suis donc ravie d’avoir pu l’en sortir après un si long sommeil, d’autant qu’il m’a permis de retrouver le style de François Mauriac dont j’avais apprécié il y a fort longtemps Le baiser au lépreux et Génitrix.
François Mauriac s’inspira pour écrire ce roman de l’affaire Canaby : Henriette-Blanche Canaby fut accusée en 1905 d’avoir voulu empoisonner son mari, Émile Canaby, courtier en vins bordelais alors endetté.
Mauriac assista à son procès en cour d’assises de la Gironde le 25 mai 1906, au cours duquel elle fut condamnée pour faux et usage de faux (fausses ordonnances pour se procurer auprès de pharmaciens de l’aconitine et de la digitaline, sans compter l’arsenic qui entrait dans la composition de la liqueur de Fowler qu’elle donnait à son mari en grande quantité).
Son époux témoigna en sa faveur pour sauver les apparences de ce couple de la bourgeoisie bordelaise qui faisait ménage à trois avec Pierre Rabot, un riche rentier. Ainsi, malgré le mobile possible d’Henriette-Blanche Canaby (toucher une forte indemnité au titre de l’assurance-vie souscrite par son mari et refaire sa vie avec son amant) et sa culpabilité criminelle assez évidente, l’accusation de tentative d’empoisonnement fut rejetée et l’épouse fut condamnée à 100 francs d’amende et 15 mois de prison, peine qu’elle n’effectuera pas en totalité.
L’intrigue de Thérèse Desqueyroux reprend en grande partie cette affaire. Comme Henriette-Blanche Canaby, Thérèse Desqueyroux va falsifier des ordonnances et donner à son mari de fortes quantités des mêmes médecines, le rendant très malade.
Comme Emile Canaby, Bernard Desqueyroux va disculper sa femme, témoigner en sa faveur pour préserver l’honneur de la famille et leur petite fille, qui doivent demeurer sans tâche.
Si Emma Bovary a tant compté dans la vie de Gustave Flaubert, Thérèse Dessqyeroux a beaucoup compté dans celle de François Mauriac car il reviendra à de nombreuses occasions sur ce personnage qui apparaît régulièrement au détour de ses romans parus les années suivantes.
La justice, c’est une chose. La vengeance, c’en est une autre. Thérèse a voulu empoisonner son mari, elle a échoué, et le scandale a été étouffé : on ne joue pas avec l’honneur d’une famille si respectable.
Mais ce qui se passe après, c’est bien pire que toutes les condamnations. Son mari se fait son juge, son bourreau, et décide de la séquestrer purement et simplement. Il ne peut pas la supprimer, il ne peut pas non plus la souffrir. Il peut en revanche l’enfermer.
Ce sera l’occasion pour Thérèse de penser à son geste, puisque de toute façon elle n’a plus que ça à faire…
<Dans ce long monologue, l’auteur dresse un portrait à charge de la bourgeoisie de son époque, dominée par les mariages arrangés et la toute-puissance masculine qui broie les femmes.
Thérèse a subi son mariage, jeune femme élevé par un père veuf qui l’a laissé mené une vie plutôt libre : elle lit beaucoup, fume, est capable de penser par elle-même, et cerise sur le gâteau, elle n’a pas la fibre maternelle : autant de points négatifs pour sa future belle-famille.
Enfermée dans sa solitude, piégée par le poids du clan, des convenances et des rumeurs, Thérèse va tenter par cet empoisonnement de regagner sa liberté et mener enfin une existence qui lui conviendrait mieux.
Si j’ai apprécié ce roman sur le fond, je l’ai peu goûté sur la forme : le rythme du récit est très lent et le personnage de Thérèse ne m’a pas plu autant que je l’aurai pensé, elle se révèle trop passive et centrée sur elle-même, sans doute parce qu’au fond, personne ne s’intéresse à elle ni lui montre de l’affection.
Un roman que je vous encourage malgré tout à découvrir car il témoigne de la vie des femmes de la bourgeoisie au début du XXè siècle et ne serait-ce que pour cela, il est intéressant à lire.
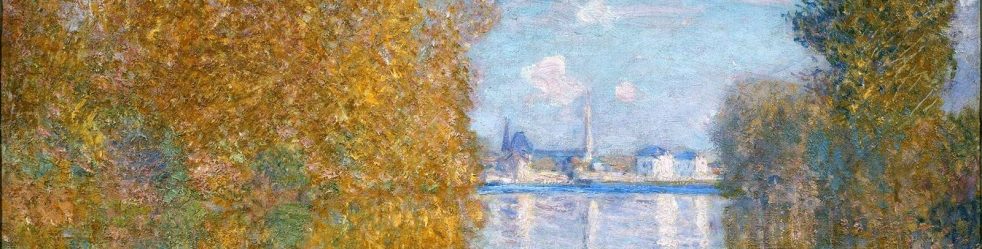
2 commentaires sur “Thérèse Desqueyroux – François Mauriac”