Lu dans le cadre du challenge 1 pavé par mois :
États-Unis, demain. Avortement interdit, adoption et PMA pour les femmes seules sur le point de l’être aussi. Non loin de Salem, Oregon, dans un petit village de pêcheurs, cinq femmes voient leur destin se lier à l’aube de cette nouvelle ère. Ro, professeure célibataire de quarante-deux ans, tente de concevoir un enfant et d’écrire la biographie d’Eivør, exploratrice islandaise du xixe. Des enfants, Susan en a, mais elle est lasse de sa vie de mère au foyer – de son renoncement à une carrière d’avocate, des jours qui passent et se ressemblent. Mattie, la meilleure élève de Ro, n’a pas peur de l’avenir : elle sera scientifique. Par curiosité, elle se laisse déshabiller à l’arrière d’une voiture… Et Gin. Gin la guérisseuse, Gin au passé meurtri, Gin la marginale à laquelle les hommes font un procès en sorcellerie parce qu’elle a voulu aider les femmes. 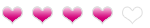

Salem, États-Unis, dans un futur très proche. Un nouvel ordre religieux règne sur le pays de l’Oncle Sam, les puritains imposent de nouvelles règles liées à la procréation : l’avortement est interdit, l’adoption et la procréation médicalement assistée seront réservés aux couples mariés.
Non loin de Salem, dans un petit village de pêcheurs, Ro, professeure célibataire d’une quarantaine d’années, essaie désespérément de devenir mère. Susan a abandonné ses études de droit pour devenir femme au foyer. Maman de deux enfants, elle est au bord du burn-out, n’arrivant plus à supporter ni son mari ni ses chérubins.
Mattie, la meilleure élève de Ro, perd sa virginité sur le siège avant d’une voiture et s’aperçoit quelques semaines plus tard qu’elle est enceinte. Enfant adoptée, elle refuse cette maternité et veut absolument avorter en dépit des risques encourus. Enfin, Gin la guérisseuse, a abandonné son enfant à la naissance, vit dans une cabane dans les bois et va être accusée de sorcellerie par le proviseur du lycée…
Lorsque l’on commence la lecture de cette dystopie, on ne peut s’empêcher de penser à La servante écarlate de Margaret Atwood avec lequel elle partage quelques points communs. Comme son illustre consœur canadienne, Leni Zumas, qui signe avec Les heures rouges son premier roman, plante son décor au sein d’une Amérique ultra conservatrice qui s’empresse de mettre fin aux avortements, réservant les enfants non voulus aux seuls couples mariés.
La comparaison entre les deux autrices s’arrêtent là. Dans ce roman polyphonique, nous suivons quatre trajectoires de femmes, quatre façons de vivre sa maternité différemment. Il y a la biographe (Ro), l’épouse (Susan), la fille (Mattie) et la guérisseuse (Gin).
L’auteure nous interroge sur les conséquences des choix politiques conservateurs : l’illégalité de l’avortement aux Etats-Unis qui a bâti un mur rose à sa frontière du Canada, ce qu’encourent les femmes y compris les très jeunes filles si elles se font prendre sur le point d’avorter, les risques qu’elles prennent en se faisant avorter dans des cliniques où les règles d’hygiène les plus élémentaires ne sont pas respectées, le coût exorbitant de la PMA, que deviennent les femmes célibataires en désir d’enfant dans un monde où la PMA et l’adoption ne sont réservés qu’aux couples mariés, la vie des femmes dans une société patriarcale où elles ne sont plus libres de disposer de leur corps, etc.
Tous ces questionnements nous rappellent que les droits acquis par les femmes sont très récents et que le moindre changement politique peut les réduire à néant, l’époque à laquelle l’auteure nous transporte est tellement proche que ça en est inquiétant.
Leni Zumas a choisi des héroïnes très différentes dont les récits s’entremêlent tout au long du récit, j’avoue que j’ai eu beaucoup de mal au début de ma lecture, je n’arrivais pas à rentrer dans l’histoire et je trouvais le récit laborieux et puis au bout de quelques chapitres, j’ai été bien ferrée et j’ai trouvé finalement cette histoire assez passionnante.
Bonne idée d’avoir choisi des femmes si différentes, de n’avoir pas cherché à les rendre sympathiques, d’avoir opté pour Salem, célèbre théâtre d’un procès aux sorcières au 17è siècle, comme décor de cette dystopie et de faire un parallèle avec Gin la guérisseuse, que l’on poursuit en justice pour sorcellerie !
Le style clinique et froid, à la fois ironique, impudique, violent et poétique de l’auteure, ne m’a pas totalement convaincue, j’ai eu du mal à m’y habituer mais cela ne m’a pas empêché d’apprécier ce roman captivant.
Les heures rouges est un roman féministe et engagé important, une lecture coup de poing indispensable dans cette rentrée littéraire qui pointe du doigt les dérives conservatrices.
Un grand merci à Anne et aux éditions Presses de la cité pour cette découverte !
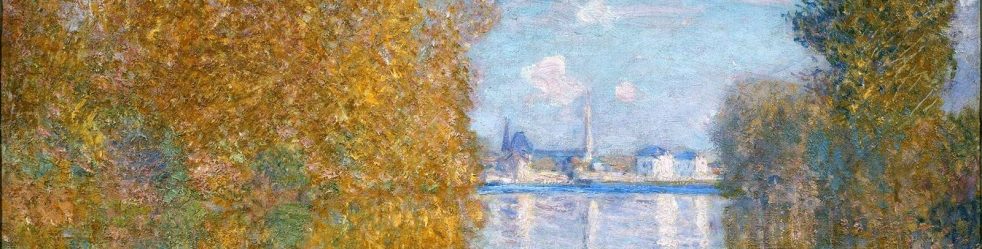

Je l’ai reçu et même si j’étais dubitative au départ, la thématique m’intéresse. J’espère avoir l’occasion de le lire rapidement !
J’espère qu’il te plaira, c’est un roman vraiment intéressant !
J’ai repéré ce titre qui me tente énormément (en effet j’ai tout de suite pensé à « La servante écarlate », non seulement à cause du résumé, mais également le titre et la couverture). Je suis contente d’avoir lu ton avis. Cela confirme mon intérêt pour ce livre!
Il y a des parallèles avec La servante écarlate en effet
je ne l’avais pas repéré, mais tu en parles très bien, pourquoi pas?!
Ravie de t’avoir convaincue !